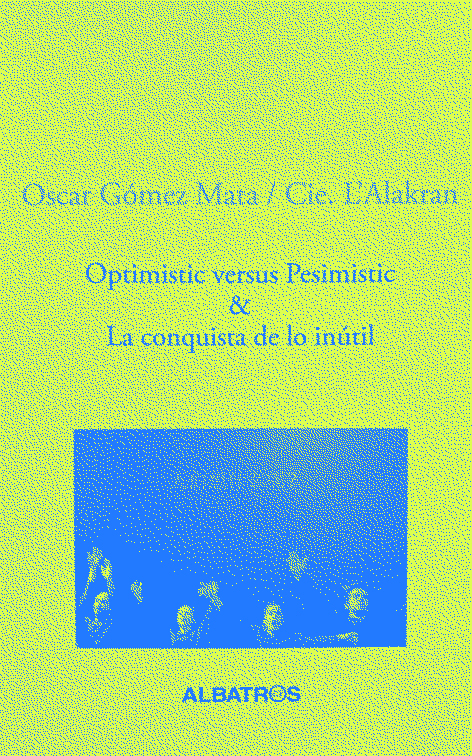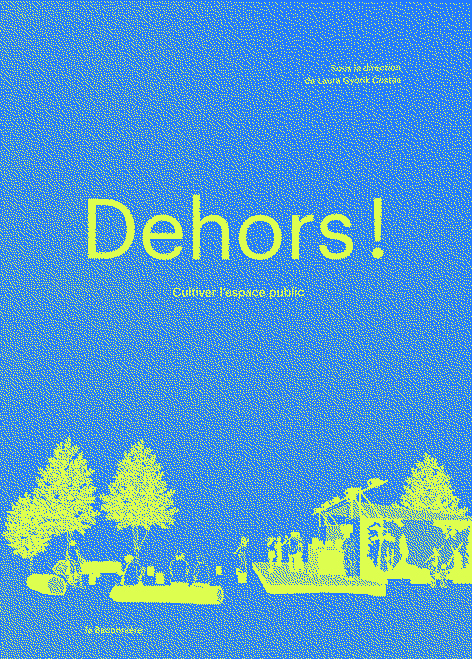Dès que les portes s’ouvrent, la salle respire un drôle d’air, vif et piquant. C’est le vent fort de la scène qui souffle en tous sens, et rien ne l’arrête. Un vent de folie qui va singulièrement prendre forme dans les corps des acteurs lorsqu’on évoque ceux de L’Alakran, il est beaucoup plus juste de dire : performeurs. Car rien de ce qui va se passer dans ce lieu n’échappe à la performance, qui prend en compte, très littéralement, cette réalité toute simple : des corps se présentent, et s’exposent, devant d’autres corps, offerts et exposés. Pour Oscar Gómez Mata, fondateur de la compagnie, il est impossible d’être comédien, s’il s’agit de faire semblant qu’on n’est pas là où l’on est quand on joue. Dès qu’il entre sur le plateau, il trimbale avec lui cette dinguerie, cette capacité à être exactement ce qu’il est, à cet instant, prêt à basculer avec nous.
Tous les spectacles performances de L’Alakran s’enracinent dans ce questionnement archaïque: comment se fait-il qu’on soit là devant vous, nous, les acteurs? Cet étonnement initial transforme l’air, et nous spectateurs. Le quatrième mur a définitivement volé en éclats, et le réel que nous vivions avant le spectacle n’a pas cessé d’exister, il entre par tous les pores du théâtre, et il sera de bout en bout la matière de la performance. Les acteurs arrivent sur scène avec la partition de leur vie, qu’ils vont peu à peu orchestrer devant nous. Une vie sans limite ni sur-moi, qui ne s’interdit rien. Une vie de Maîtres-Fous qui nous entraîne dans leur vertige, baroque et luxuriant.
Les êtres qui déboulent sur le plateau sont chargés d’une énergie de taureau. A moins qu’il ne s’agisse de la maîtrise précise du torero. Ou un mixte des deux, ou le passage de l’un à l’autre. C’est la grande force d’Oscar, grandiose et pathétique maître de cérémonie, toujours présent sur le plateau, capable en permanence de souffler le chaud et le froid, parfaitement bicéphale, suisse d’adoption, à l’évidence, mais toujours espagnol, et jusqu’au bout des griffes.
Les spectateurs sont propulsés, avec armes et bagages, dans ce “théâtre libre” où tout est possible. Dans Kaïros, sisyphes et zombies, Gómez Mata met en scène sa propre mère, Maria, plus vraie que nature. La compagnie de cette vieille femme en blouse fatiguée aiguise puissamment les regards. D’autant plus qu’elle cohabite avec un immense portrait de l’acteur Charles Dullin… Un effet de réel encore renforcé par l’irruption sur le plateau d’un vendeur de roses indien, Lakshman, sommé de répondre à un désopilant questionnaire pour un sondage politique — en réalité, la vraie réalité, un cadre supérieur travaillant dans une grande entreprise de parfums de Genève.
Là est la magie de l’Alakran, un chamanisme de la scène, qui vrille et explose le pacte de fiction ainsi que la frontière en apparence assez claire entre le vrai et le faux, le réel et le contrefait. Il devient en effet rapidement impossible de démêler l’un de l’autre, et plus on croit être dans la réalité, plus on est dans le faux. Car les performances de l’Alakran ne se privent pas pour autant de nous raconter des histoires, des histoires folles et raides qui tournent vite au cul-de-sac, avant de rebondir sans queue ni tête, pour finalement taper juste, au cœur du réel.
Pour financer la prestation du « vendeur de roses », Oscar Gómez Mata fait monter sur la scène son administratrice — la vraie, celle-là, Barbara Giongo, dont la présence fidèle accompagne la compagnie depuis ses débuts. Elle remet un chèque à Lakshman, avant de détailler les diverses provenances du budget du spectacle. Chaque représentant de chaque tutelle, direction, collectivités locales, Etat est appelé à monter sur le plateau, pour faire en direct le chèque correspondant au montant de la soirée. Se reconstitue à vue devant nous l’ensemble de la chaîne de production, incarnée dans la lumière par ceux qu’on ne voit jamais, et dont le métier est de rester dans l’ombre.
Les performances de l’Alakran repoussent les limites du théâtre et en font un espace profondément libre, où tout est possible. Quitte à nous rendre les témoins complices d’expériences profondément limitées. Dans Optimistic versus pessimistic, Oscar Gómez Mata met en scène devant nous, au plus près de nous, spectateurs, répartis partout dans l’espace, un groupe de figurants, qui, les yeux bandés, ont pour tâche de déplacer une série de meubles d’un bout à l’autre du plateau. Les “spectateurs” ont toute liberté de les aider, de ne rien faire ni dire, voire… de rajouter des obstacles. Une séance d’humiliation consentie, … et rémunérée, ponctuée par des coups de trompette qui obligent les figurants à se vautrer face contre terre. Ad libitum… Sans oublier cette scène mémorable où les spectateurs sont invités à défoncer un homme en armure avec des poivrons rouges et jaunes, pour faire baisser leur taux de violence intérieure. Là encore, rien ne nous rattache au monde protégé de la représentation. L’acteur essuie vraiment les coups, et certains s’en donnent à cœur joie, sans limite.
Cette force d’un théâtre libre, où tout peut se dire, prend la forme d’un espace d’expression libre, où la scène offre les moyens de prendre la parole à propos de la vie de la cité. Dans Suis à la messe, reviens de suite, le plateau devient l’occasion d’un forum de réaction directe à l’actualité immédiate. Un baron de la scène culturelle se fait épingler pour ses propos réactionnaires dans le débat qui secoue la société suisse autour du statut des artistes. Une traduction genevoise de la position élitiste et méprisante de Patrice Chéreau pendant le conflit des intermittents en 2003. La nomination du nouveau directeur de la Comédie de Genève est également épinglée. Où l’on découvre que le théâtre peut devenir un média, quand il a le courage de s’emparer des questions du moment, sans médiation.
Mais cet engagement dans la vie, qui fait dire au bonimenteur d’Optimistic versus pessimistic — l’art, un engagement pour la vie! —, ne doit pas gommer la dimension furieusement drolatique des spectacles de l’Alakran. Ses acteurs, étroitement co-auteurs de l’écriture des pièces de la compagnie, trimballent avec eux l’imaginaire tonitruant de la culture populaire espagnole, y compris dans ses formes les plus arpentées, la tauromachie, le flamenco, l’Andalousie, l’art de la fête, le tout revu par une movida seconde génération à bout de souffle.
Oscar Gómez Mata ne se résume pas à la virtuosité d’un performeur tout terrain, il est aussi un grand pédagogue, épaulé par une méthode rigoureuse mise en place au fil des ans et des ateliers. Son principe pédagogique est très simple, et redoutablement efficace: toute journée de travail dans l’école, du lever au coucher, est une seule et même performance. En activant concrètement ce postulat sur le plateau, il parvient à transformer, à vue, des comédiens en écrivains de leur propre vie. J’ai eu la chance d’être témoin d’une telle expérience de transformation, lorsqu’il a travaillé avec la promotion E de la Manufacture, en leur posant cette question: quand vous regardez Opening night de John Cassavetes, quel vertige ce film vous donne envie de traduire? Et le plateau offrira de magnifiques réponses, consignées dans un spectacle chargé de vie, Entre, magiquement repris sous chapiteau au festival d’Avignon.
Plus secrètement, l’homme de théâtre est aussi un grand rêveur métaphysicien, épris de physique quantique, d’astronomie et de sciences de la matière. Il aime à provoquer des croisements entre des régimes d’expériences en apparence lointains, et pour le moins inattendus. À propos de sa rencontre avec l’astrophysicien Michel Cassé, Gómez Mata évoque la force qu’elle déploie pour les artistes : J’ai remarqué qu’en amenant un scientifique de premier plan dans un espace de création, un suscite un moment marquant. On ne comprend pas tout, mais pour l’avoir vécu, je sais que sa parole n’a rien d’hermétique, et qu’elle arrive à trouver les mots pour parler des neutrinos et des anges, dans une seule et même phrase. Il nous aide à trouver des ponts. (Oscar Gómez Mata, entretien avec Bruno Tackels, Empreintes n°3, le journal du Festival Hybrides 2010)
Depuis qu’il réfléchit à la dimension active et dynamique du public, considérée comme une réalité à part entière, vivante et organique, Oscar Gómez Mata se retrouve assez naturellement de plain-pied avec un homme qui observe l’univers dans son labeur journalier et dit qu’il n’y a pas seulement trois dimensions, mais dix, ou onze, et qu’il y a des dimensions insoupçonnées dans ce que nous nommons la réalité. En évoquant ces questions avec des comédiens professionnels, j’ai pu observer comme elles touchent leur esprit, et permettent de regarder, de vivre la réalité autrement. C’est exactement ce qui se joue dans les performances de l’Alakran, qui filtrent la réalité pour la rendre délicieusement insupportable.
La scène devient le vivarium où sont disséquées les diverses manières dont le monde contemporain nous affecte. Un laboratoire de nos petites pathologies du quotidien. Comment le capitalisme qui s’est insinué dans nos veines nous déshumanise lentement, mais sûrement. À la recherche de l’antidote, désespérément. Si vous avez une piste, écrivez à l’Alakran.
Article paru dans le livre 30 ans à Paris édité par le Centre culturel suisse de Paris – 2015